|
[La
thèse d’une religion première centrée sur les femmes et le
culte d’une grande Déesse-Mère a encore ses partisans. Elle
s’appuie sur l’existence de statuettes répandues à la
période néolithique et représentant des femmes nues et aux
formes opulentes.]



Quelques exemples de
statuettes néolithiques – successivement : la « Danseuse »
de la tombe 2 de Ma’americh (IVe millénaire, Égypte) ;
Cucuteni (Ve millénaire, Roumanie, province de
Moldavie) ; Golovita, culture de Hamangia (VIe-Ve
millénaire, Roumanie).
Certes le nombre de telles statuettes est impressionnant :
30 000 rien que dans les Balkans,
et des statuettes analogues au Proche-Orient, en Anatolie,
en Égypte, et en Europe orientale. Mais, sauf exception,
elles ne sont pas associés à des lieux de cultes, ni à des
temples, structures d’ailleurs toujours difficiles à
identifier en archéologie. Elles ne sont nullement
impressionnantes par leur facture, souvent grossière, ni par
leur taille qui dans la plupart des cas n’excède pas
quelques dizaines de centimètres : une photographie publiée
par Müller-Karpe (1973 : pl. p. 63) témoigne bien de ce
contraste entre le caractère très élaboré des poteries et le
caractère fruste de ces statuettes.
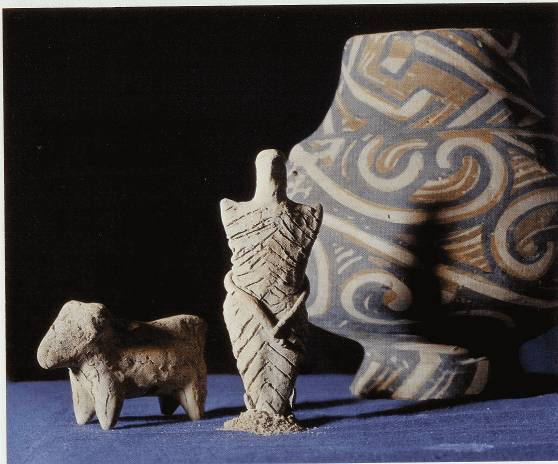
Vase polychrome, statuette
humaine et figurine animale de Cucuteni (Ve
millénaire, Roumanie, province de Moldavie).
Le
phénomène n’est d’ailleurs pas propre au Néolithique
puisqu’il était déjà présent au Paléolithique et se
continuera à l’âge du Bronze. Pourquoi alors cet intérêt
excessif porté aux statuettes d’âge néolithique ? En raison
de leur nombre ? Sans doute, mais aussi en raison d’une
assez vieille idée comme quoi les femmes auraient inventé
l’agriculture et, ce faisant, auraient aussi donné naissance
à une nouvelle société, plus douce que celles des chasseurs.
Société aimable que dirigent les femmes, avec
corrélativement un panthéon surplombé par la figure d’une
grande Déesse-Mère, symbole de la primauté donnée à
l’agriculture et de la prépondérance des femmes tout à la
fois. Ensuite viendront les sociétés plus violentes et
patriarcales dominées par les guerriers, avec des panthéons
dominés par des dieux mâles. Le premier à avoir fait ce rêve
d’un âge d’or sous l’égide de femmes maternelles et de
déesses bienveillantes fut Bachofen en 1861. Un siècle plus
tard, ce sont pratiquement les mêmes thèses que présente M.
Gimbutas
tout au long d’une œuvre prolifique mais entièrement
organisée autour d’une seule idée. Elle reprend de Bachofen
toutes les thèses, y compris celle qui veut que le règne des
femmes ne soit pas l’inverse exact de celui des hommes (car
à vrai dire Bachofen ne parle pas de « matriarcat », mais
seulement de Mutterrecht : « droit maternel »), ne
consistant pas en domination, mais plutôt en harmonie. Elle
se borne à raccrocher ces thèses aux données archéologiques
qui faisaient défaut à Bachofen : pour l’époque néolithique,
ce sont les statuettes de « déesses-mère », et la fin de
cette période bienheureuse est identifiée avec l’arrivée de
peuples guerriers associés à des chars, lesquels seraient,
selon une thèse déjà ancienne, les Indo-Européens. Je passe
sur ce dernier point qui est totalement en dehors de mon
propos et qui a déjà fait couler pas mal d’encre, pour ne
m’attacher qu’à la question centrale : qu’est-ce qui nous
fait croire que les femmes auraient été mieux loties au
Néolithique qu’ensuite ? qu’est-ce qui nous fait croire que
les religions néolithiques auraient été vouées au culte des
Déesses-Mères ? Uniquement les statuettes de femmes
dénudées, et rien d’autre. C’est le seul et unique argument
en faveur de la « Grande Déesse ». Aucun autre type de
données archéologiques ne milite en faveur de cette
hypothèse. Les tombes (très nombreuses) d’époque néolithique
ne témoignent nullement d’une quelconque prépondérance des
femmes ; les cultes, en raison de la difficulté de les
repérer en archéologie, ne témoignent de rien du tout ; les
temples sont difficilement identifiables ; quant aux plans
de villages, qu’il convient de compter parmi les documents
les plus importants sur la vie sociale, ils ne témoignent
pas plus de quoi que ce soit sur la condition féminine.
Reste donc les statuettes et les seules statuettes. Leur
prolifération est-elle l’indice d’une situation privilégiée
des femmes ?
L’image de la femme
J’ai
grand peur qu’il faille répondre par la négative, pour une
raison très simple. C’est en effet que partout, dans
toutes les sociétés connues, ce sont les hommes qui
manipulent les images de femmes, tout particulièrement de
femmes dénudées, et ceci n’est pas le signe d’une
quelconque prépondérance féminine, mais seulement une des
traductions les plus ordinaires de la domination masculine.
Rien
n’est plus significatif à cet égard que notre actuelle
« civilisation de l’image », ainsi qu’on l’a qualifiée
depuis maintenant plus de cinquante ans. La publicité
utilise inlassablement les mêmes images de sirènes
alléchantes ou provocantes, pour solliciter le chaland. Tout
un chacun sait qu’il ne s’agit que de vendre ou de faire
vendre, et peu importe qu’il s’agisse d’un dentifrice, d’un
modèle de voiture, d’un voyage ou de promouvoir un nouveau
film ou un nouveau disque. Et personne […] ne conclurait à
la glorification de la femme, laquelle ne joue dans cette
affaire tout au plus qu’un rôle instrumental. Cela est
suffisamment connu pour qu’il ne soit pas nécessaire d’y
insister. Mais s’agit-il là d’un trait propre à notre seule
époque contemporaine ? L’actuelle prolifération de
l’imagerie suggestive l’est assurément, mais pas les
représentations de femmes dénudées qui abondent dans
l’histoire de l’art, de l’architecture ou de la décoration
occidentale. Au XIXe siècle, elles se dressent en
candélabres autour de l’Opéra de Paris, elles s’allongent
sur le pont Alexandre III, tout comme elles le font
lascivement dans la peinture dite « pompier » de cette
époque. Aux XVIIIe ou XVIIe siècles,
leurs bustes ornementent les pilastres et agrémentent de
diverses façons les façades des hôtels particuliers. Les
proues de navires s’ornent pareillement de poitrines
féminines offertes à la bise. Et déjà à la Renaissance, leur
nudité s’allonge parmi les décors des châteaux, pour le seul
plaisir du roi et de la cour, et sans même prétendre y jouer
le rôle de cariatides.
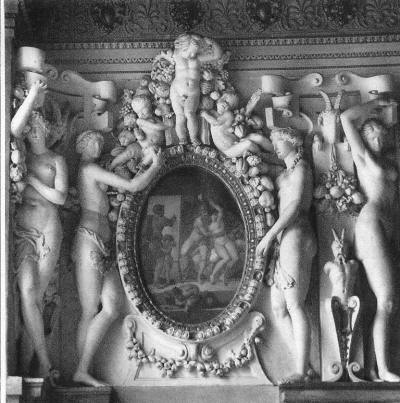
Stucs du Primatice à
Fontainebleau (Renaissance).
[…]
Tournons nous à présent vers ces civilisations restées de
tradition orale jusqu’à la colonisation, qui n’ont pas connu
l’institution de l’État et sont restées en marge des dites
grandes religions qui si souvent ont marché du même pas que
les grands empires. Laissons de côtés les petites sociétés
d’Asie des collines ou des îles, lesquelles, bien qu’elles
se soient tenues à l’écart des civilisations, n’ont pas
manqué d’être influencées, les unes par le bouddhisme ou
l’hindouisme, les autres par l’islam. Laissons également de
côté les Amériques, marquées par un art principalement
animalier, en dehors des grands États, sinon des grands
empires, des Andes et du Mexique que l’on mélange si souvent
dans la notion d’art précolombien avec les peuples
périphériques, nomades et anarchiques. Laissons de côté les
détails, les cultures particulières. Entrez seulement dans
la récente section des Arts premiers du Louvre, vous y
verrez une majorité de représentations féminines. Ouvrez
seulement un livre sur les arts d’Afrique noire ou
d’Océanie, vous ferez le même constat. Rien n’est plus
courant, rien n’est plus banal que ces statuettes
généralement de bois qui représentent des femmes aux
poitrines bien marquées, fortement sexualisées, l’appareil
génital étant le plus souvent aussi peu dissimulé.
|

Haut d'une
statue-pilon, Senufo, Côte d'Ivoire (Zürich,
Rietberg Museum). |

Statue féminine sur
crochet, Iatmul, moyen Sépik,
Papouasie-Nouvelle-Guinée (collections
Barbier-Mueller). |
Mais
aucun ethnologue, aucun historien de l’art n’en a jamais
conclu de cette prépondérance de représentations féminines à
la prédominance des femmes dans la société. Parce que tout
un chacun sait bien que la situation des femmes africaines
ou océaniennes, pour être différente de celle des femmes
dans la culture grecque, romaine ou chrétienne, n’y est en
aucune façon meilleure.
Ce
sont partout les hommes qui fabriquent ces statuettes et
presque partout eux qui les utilisent, les stockent, les
disposent dans les cases ou au fronton des maisons des
hommes, ou sur les lieux de culte. Elles représentent les
épouses des ancêtres et, plus rarement, en régime
matrilinéaire, les femmes ancêtres elles-mêmes. Parfois,
elles sont les mères mythiques. Associée à une
représentation masculine au caractère sexuel tout aussi
ostensible, une telle statuette représente le couple
primordial dont est issu toute l’humanité. Partout, elles
sont les génitrices ou les mères dans leur fonction
éducatrice, elles symbolisent l’idée générale de maternité,
celle de fécondité. Car dans toutes ces sociétés, il est bon
d’avoir de nombreux enfants, pour travailler les champs ou
défendre ses droits, les armes à la main. La puissance d’un
homme se juge au nombre de gens qu’il réussit à garder sous
sa houlette, et d’abord au nombre de ses enfants, lequel
dépend évidemment du nombre de ses épouses et de leur
fécondité. Nul mystère donc à ce que ces sociétés
représentent si souvent la femme sexualisée ; nul doute
également que ce ne soit pas là une façon de valoriser la
féminité en elle-même. Les femmes ne sont que les objets et
les moyens des stratégies masculines.
[…]
Références citées dans cet extrait :
Cohen,
Cl. 2003 La femme des origines ; Images de la femme dans
la préhistoire occidentale. Paris :
Herscher.
Gimbutas, M. 1974 The gods goddesses
of Old Europa, 7000-3000 BC: Myths, legends & cult images.
Berkeley & Los Angeles: University of California
Press.
Guilaine, J. 1994
La mer partagée : La Méditerranée avant
l’écriture, 7000-2000 avant Jésus-Christ. Paris :
Hachette.
Müller-Karpe,
H. 1973 [1968] L’art de l’Europe préhistorique [trad.
de l’all.]. Paris : Albin Michel.
Przyluski, J. 1950
La grande déesse : Introduction à
l’étude comparative des religions. Paris : Payot.
Ucko, P.J. 1962 The interpretation of
prehistoric anthropomorphic figurines. Journal of the
Royal Anthropological Institute 92: 38-54.
Ucko, P.J. 1965 Anthropomorphic ivory
figurines from Egypt. Journal of the Royal
Anthropological Institute 95: 214-239.
Ucko, P.J. 1968 Anthropomorphic
figurines of prehistoric Egypt and Neolithic Crete. Londres: Andrew Szmidla.
|